
Ce chapitre contient des mots dont il semble important de préciser le sens pour être compris dans cette acception. D’autre part, se trouvent également les vocables utilisés par Thoinot Arbeau qui ont, la plupart du temps, plusieurs significations suivant le contexte où ils sont employés, qu’il s’agisse d’un nom ou d’un adjectif. Pour ce qui concerne les pas de danse et leurs affects, ils seront développés dans les chapitres correspondants.
Art ménétrier : j’ai inventé cet idiotisme dans les années 1990 pour spécifier la fonction de jouer la musique pour la danse. Lorsque nous parlons d’art ménétrier, cela implique que le ménétrier (musicien récréatif professionnel) a la parfaite maitrise de l’ajustement du jeu instrumental et vocal, avec une attention particulière sur les tempi, les articulations, les phrasés, les dynamiques, les variantes en lien avec les chorégraphies.
Ménétrier : De la fin du Moyen-âge et jusqu’à la dissolution de la corporation un peu avant la Révolution Française, un ménétrier était un musicien professionnel employé pour jouer de la musique profane lors de diverses cérémonies et pour mener la danse. Au XXe siècle, comme nous pouvons le lire dans le Petit Larousse 2004 la définition de « ménétrier » est : « n.m. (de ménestrel en latin ministerium : service). Anc. Dans les campagnes, homme qui jouait d’un instrument de musique pour faire danser ». Nous comprenons donc que seule la fonction de « faire danser » subsiste et concerne les zones rurales et les musiciens « amateurs », dans son sens statutaire. Aujourd’hui, c’est un raccourci « d’art ménétrier » et synonyme de sonneurs, de meneurs de danse, de maître à danser qui indique seulement une fonction particulière du musicien : jouer au service de la danse.
Assiette (de pas) : Du verbe asseoir. Appui au sol du pied droit ou gauche.
Basse danse / Basse-danse / Bassedanse : Il faut absolument distinguer deux sens. Premièrement la « catégorie des basses danses », également définie comme danses basses, qui est une famille de danses caractérisées par une exécution sans saut, proche du sol (ex. la pavane). Cette terminologie s’oppose aux « danses hautes ». Secondement, elle désigne une danse à part entière composé, selon TA, de trois mouvements : bassedanse, retour de bassedanse et tourdion (lent, lent, vif). Dans mon enseignement, je choisis de distinguer ces deux sens avec un pluriel invariable en séparant, avec ou sans trait d’union, « basses » et « danses » pour désigner la catégorie et d’écrire « bassedanse » en un seul mot pour parler exclusivement de la danse. Il convient de préciser que ces trois orthographes sont présentes dans les traités et les partitions éditées aux XVe et XVIe siècles.
Branle double /double : Je dénombre trois sens possibles pour le mot « double » quand il est utilisé dans les danses de la Renaissance française :
- L’idiotisme « branle double » est un nom de danse.
- « Double » : seul et utilisé comme un nom correspond à un pas de danse construit sur quatre temps. Il peut être qualifié de gauche ou de droite.
- « Double » : seul et utilisé comme un adjectif signifie que la musique est construite sur 8 temps. Ainsi un « Branle de Poitou double » est un branle de Poitou construit sur une phrase musicale de 8 temps.
Branle simple /simple : Je dénombre trois sens possibles pour le mot « simple » quand il est utilisé dans les danses de la Renaissance française :
- L’idiotisme « branle simple » est un nom de danse.
- « simple » : seul et utilisé comme un nom correspond à un pas de danse construit sur deux temps. Il peut être qualifié de gauche ou de droite.
- « simple » : seul et utilisé comme un adjectif signifie que la musique est construite sur 6 temps. Ainsi un « Branle de Poitou simple » est un branle de Poitou construit sur une phrase musicale de 6 temps.
Concordance : Mot désignant une mélodie proche d’une autre ou le nom d’un morceau proche d’un autre.
Congruence : Sur une partition, signe qui indique l’endroit où il faut reprendre la musique lorsque l’on arrive à une double barre ou une barre de mesure.
Danserie : Mot désignant une musique à danser de la Renaissance.
Démarche : Chez TA le mot « démarche » signifie au premier abord : marcher à reculons. Cependant, nous pouvons quand même questionner cette définition en pensant qu’il peut également être un synonyme de « revers ». C’est-à-dire faire le même pas mais en commençant de l’autre pied.
Gravure : Dans le cadre des éditions du XXIe siècle, ce sont des partitions réalisées avec des outils informatiques.
Léger : Deux sens différents, le premier est une indication de tempo (synonyme de rapide, vite et concis), le second, tout comme Saltarelle, courant(e), triple, sarabande, reprise est une indication de ternarisation. Notons que, dans le second cas, les compositeurs n’ont jamais attribué le mot « léger » aux « danses de marches ». Le terme se rencontre exclusivement au côté des branles.
Mesure : Le sens du mot « mesure », pour les musiques des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, désigne un espace-temps délimité par deux barres dans une partition musicale. Elle consiste à quadriller le morceau. Pour les compositeurs plus tardifs, la mesure équivaut à la délimitation d’une phrase musicale. A la Renaissance, ces deux sens existent, mais dans les descriptions de TA il est essentiellement utilisé comme synonyme du « temps musical », de la pulsation actuelle, qui peut être court, long, primaire, binaire ou ternaire.
Revers : Terme désignant la reprise exacte du pas de danse précédent, mais en commençant par l’autre pied. Cf. également « démarche ».
Signature : La signature d’un morceau de musique est tout simplement l’ancêtre des chiffres indicateurs. C’était donc des signes qui pouvaient être agrémentés d’un chiffre. Aujourd’hui, nous conservons deux signes de mesures imparfaites : C et C
Auteur de l’article :
Robin Joly
Directeur musical & chorégraphique de la Compagnie Outre Mesure.
Choréologue, chorégraphe, musicien & danseur.
Ces autres articles pourraient vous interesser…


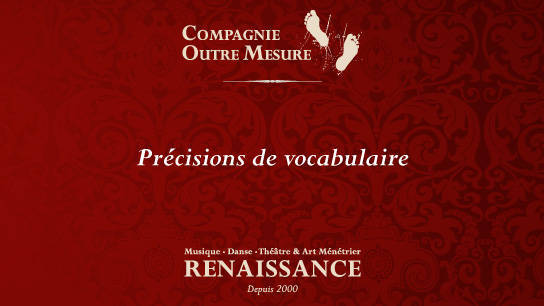














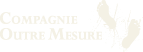


Laisser un commentaire
Envie de laisser un commentaire ?N'hésitez pas !